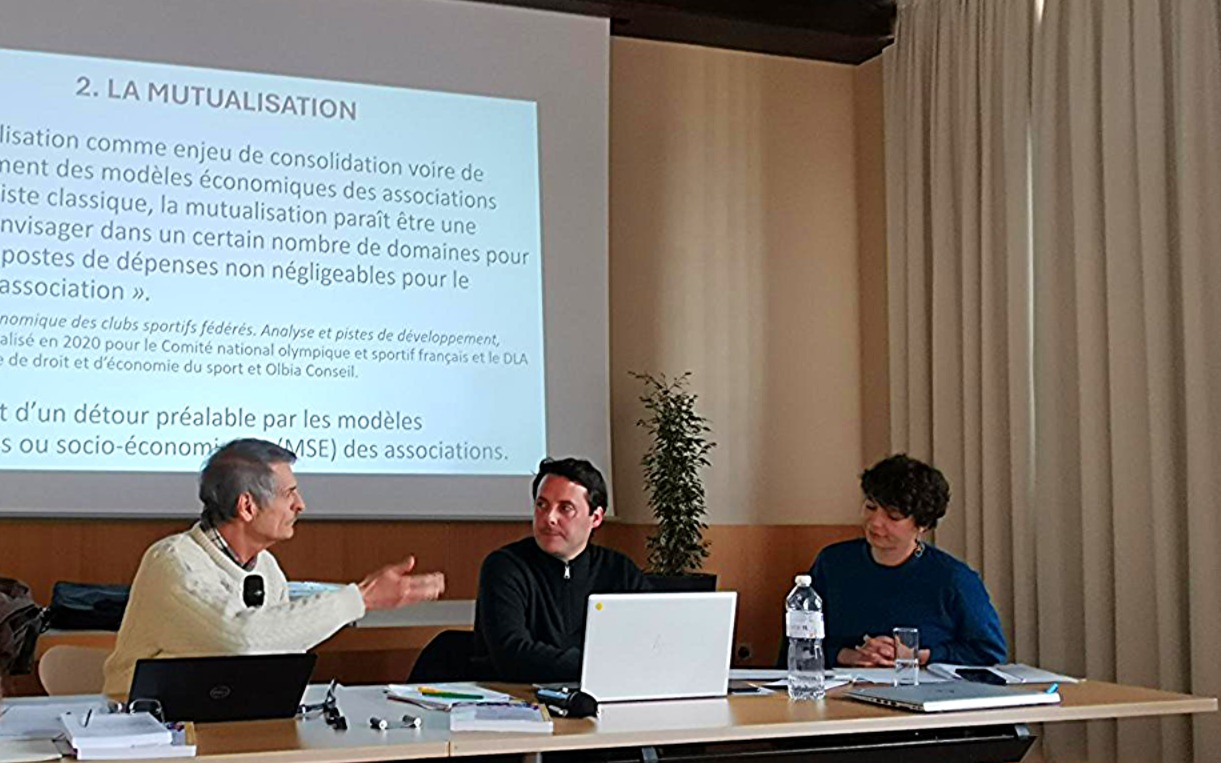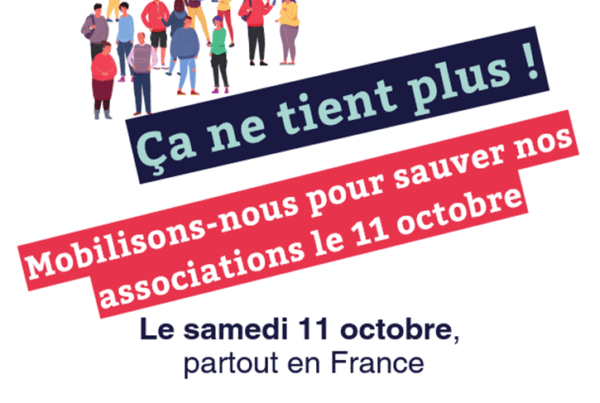Lors d’une conférence de Lionel PROUTEAU organisée à l’initiative du CADRAN (Centre pour Accompagner et Développer les Ressources pour les Associations Nantaises), acteur·ices associatives et collectivités ont été invités à prendre du recul sur la notion de mutualisation.
Lors d’une conférence de Lionel PROUTEAU organisée à l’initiative du CADRAN (Centre pour Accompagner et Développer les Ressources pour les Associations Nantaises), acteur·ices associatives et collectivités ont été invités à prendre du recul sur la notion de mutualisation.
Quelques chiffres pour planter le décor : selon l’enquête « paysage associatif » menée par L.PROUTEAU et V. TCHERNONOG, il y a en France 144000 associations employeuses et autour de 1,26 millions d’associations non-employeuses en 2020.
Si les créations d’associations foisonnent à nouveau après la crise du covid, il n’en n’est pas de même pour le modèle économique de ces structures. En effet, les subventions publiques n’ont cessé de baisser dans la part du budget global des associations (sans que cela soit forcément le cas dans leur masse) et sont remplacées progressivement par des recettes contractuelles : en clair, des financements pour des projets précis et plus pour un fonctionnement global. L’emploi associatif a également subi un retournement de situation, en progressant désormais moins vite que dans le reste du secteur privé. Plus récemment, les coupes budgétaires massives annoncées par l’Etat et les collectivités sont venues à nouveau questionner les modèles socio-économiques des associations, et remettant sur la table le sujet de la mutualisation, pour pérenniser un modèle socioéconomique en difficulté
Or, Lionel Prouteau nous met en garde « « La mutualisation n’est pas une solution miracle à la baisse des subventions, pas plus qu’elle ne peut être considérée par les pouvoirs publics comme une baisse des dépenses à court terme. »
Dès lors, si les effets attendus sont en majorité positifs -maitrise de coûts et du temps, professionnalisation des équipes, surplus coopératif- quelles sont les conditions d’une mutualisation réussie ?
Premièrement, ne pas la considérer comme une fin en soi mais bien un moyen de parvenir à un objectif qui représente une réelle valeur ajoutée. Vient ensuite la question de la préparation de la démarche, qui suppose d’instaurer un climat de confiance et d’échange entre les parties prenantes. Sur ce point, l’appartenance à des réseaux apparaît comme grandement facilitante, de même que l’implication des pouvoirs publics comme ressource en communication, ingénierie, mise en relation des acteur·rices. Cette phase préparatoire doit permettre aussi d’identifier les problèmes induits par la mutualisation et la façon d’y réagir ensemble. Enfin, une démarche réussie doit permettre d’atteindre des objectifs communs sans délaisser ceux de chacun des partenaires impliqués, afin d’en répartir équitablement les bénéfices.
Voilà pour les conseils, sur lesquels plusieurs participants·es, associatifs et agents de collectivité ont pu réagir. Il en ressort que les démarches de mutualisation ne vont pas de soi, mais pas principalement en raison d’un manque de volonté de la part des associations. En effet, le risque de perte d’identité, d’autonomie et de sens du projet associatif est bien ressenti, dans un climat teinté d’interrogation quant à la place des pouvoirs publics . Côté collectivité, le sentiment de solitude exprimé cet après-midi face à des demandes croissantes et d’autres co-financeurs qui se désengagent poussent à faire de la mutualisation une condition à la poursuite du soutien aux associations. Et les financeurs privés dans tout ça ? Une salariée d’une fondation prend la parole, elle souhaiterait soutenir ce type d’initiative mais ne sait pas quelle place prendre dans la démarche.
Pour finir, si l’on s’accorde sur les bénéfices des démarches de mutualisation, il ressort des discussions qu’elles ne peuvent tenir que du sur-mesure : ajustées au plus près des besoins et objectifs partagés et respectueux des valeurs de chacun·e, dans une temporalité non contrainte, et sur des territoires rompus au travail en réseaux.
C’est ce que nous retiendrons de cette conférence au Mouvement associatif : les têtes de réseaux peuvent agir comme agent facilitateur des dynamiques multi-partenariales dans des démarches de mutualisation, engardant toujours en tête qu’elles doivent servir le projet associatif et politique des structures qui s’y engagent.